Lever difficile, même l’eau de la douche ne m’éclaircit pas les idées. Journée de TD en perspective, préparés rapidement, interros prévues, ça s’annonce compliqué. Pas très motivant : humeur à l’indifférence. Départ juste à l’heure, presque en retard.
Dans le métro, compile « Dusty » sur les oreilles, nostalgie de l’electro d’il y a deux ans. Debout dans le RER, assis à Denfert. La musique m’agace, je l’arrête, pas envie de Gide, il me faut du plus facile : je sors le Technikart que je n’ai pas fini. Un dossier sur la presse alter, les « bonnets péruviens » qui m’ennuient. Puis un autre sur Depeche Mode, ces shampouineuses moins pédées que je ne l’aurais cru. Le RER s’est vidé entre temps, il fait beau, c’est agréable. Un coup d’œil par la vitre : Robins… Robinson ? Putain de bordel de merde, je me suis planté de RER. Coup d’œil à mon téléphone : 9h30, j’ai TD à 10h15, ça va être chaud.
Le RER stationne un temps interminable. On part enfin. Je me lève, je me mets devant la porte nerveusement, comme pour faire avancer le train plus vite. Une station, deux stations, trois stations : Bourg-la-Reine. Je détale comme un lapin, ivre de mon retard. Une minute après, le bon RER.
Arrivée à bon port à 10h05. Je descends en courant vers la vallée. Mes Etnies font un potin d’enfer : ben oui, semelles plates. Je m’essoufle, putain, qu’est-ce que je suis vieux. Je capitule, je décroche : je trotte à peine. Je chope les photocopies au secrétariat. Je grimpe les deux étages en volant au-dessus des marches. Les portes coupe-feux sont toutes fermées. Putain de fac où tout est déglingué.
Devant la porte mes étudiants attendent : bizarre. Dedans, un prof n’a pas fini sa colle. Sèchement « Euh, Monsieur, j’ai TD dans cette salle. — (confus) Oui, je sors tout de suite. » Mes étudiants s’installent, je n’ai plus de souffle, je suis en nage, sûr que demain je n’ai plus de voix. À peine ma craie touche-t-elle le tableau que l’alerte incendie retentit. Damned, il faut sortir. Ça me fait grave chier, déjà qu’on allait être à la bourre avec tout ce qui était prévu. On descend dans l’anarchie complète. Je ne suis absolument pas formé pour ce genre de choses. Dehors un rigolo a un brassard et un mégaphone. Il faut aller au point de rassemblement un peu plus loin : on n’a que ça à faire.
Je papote un peu avec mes étudiants. C’est étonnamment informel, plutôt attendrissant. Un peu malaisé, incongru. Les filles me demandent si je suis encore étudiant. Oui, mais moi je regrette le temps où on me faisait cours et où on me posait des exercices. Maintenant les exos, c’est à moi de me les poser. Et c’est dur.
On finit par remonter. Une demie heure de perdue. Je dis que je la rattrape en fin de séance, les étudiants ronchonnent, disent qu’ils ne peuvent pas. Du coup on fait l’interro immédiatement, et ceux qui voudront partir à la fin prendront leurs responsabilités. La suite se passe assez bien. Je ne les garde qu’un quart d’heure de plus, je rends les DM en essayant d’adoucir mes remarques toujours trop sèches à l’écrit par des commentaires individuels plus compatissants. Ça a l’air de marcher ; à la sortie j’ai une petite troupe de filles qui viennent me poser des questions sur le cours.
Il reste une heure avant le prochain TD. Une heure pour aller au resto du personnel, bouffer et revenir. Heureusement à cette heure il n’y a pas de queue. Sauf que j’ai oublié le décalage dû à l’alerte au feu. Quand j’arrive, c’est blindé devant le resto, et j’aperçois mon chef dans la queue ; la dernière personne que je voulais voir. Prenant prétexte des courants d’air, j’arrive à me planquer dans ma capuche. Ça n’avance pas, une vraie plaie. Quand j’ai passé la caisse avec mon plateau, il me reste à peu près dix minutes pour manger.
Je lape ma soupe comme un chien, je me bats avec la côte d’agneau, tant et si bien que je fous des haricots partout dans mon plateau. J’ai l’air fin face à ma voisine qui dissèque méticuleusement son saumon dans son assiette. J’ai pris un cône et une banane pour les embarquer sur le chemin du retour. Je sors, tout empêtré dans mes fringues, avec mon cartable qui pèse deux tonnes et ce cône glacé coincé entre deux doigts. Je le mange comme je peux, je sens que j’ai de la glace qui coule dans ma barbe, vraiment, que du bonheur. Je cherche un mouchoir dans ma sacoche pour m’essuyer, mais… Ma sacoche ! Putain de bordel de merde, je l’ai oubliée au resto. Et le °g°erbiPod qui est dedans, en plus… Je rebrousse chemin en courant comme un dératé, mon téléphone sonne, numéro inconnu, ben celui-là, il attendra. J’arrive au resto, je retrouve mon sac, tout y est, ouf, je suis juste en retard.
Le message est de mon collègue biologiste qui doit faire le TD avec moi : on essuie les plâtres aujourd’hui. Il va être en retard. À cause du RER. Génial. Dans un accès de mauvaise foi, je me dis qu’on m’a encore refilé un sacré loulou. Et ensuite je souris en pensant à ma matinée. J’arrive seulement deux minutes en retard, tout dégoulinant de sueur, je m’éponge avec un kleenex comme une mémé. J’explique que mon collègue de bio est en retard. Regards de poules qui ont trouvé un couteau. « Ah, vous n’êtes pas au courant ? Et je parie que vous n’avez pas les sujets de bio… Non, non, ce n’est pas grave. » Il va juste falloir que je descende les faire photocopier en catastrophe. J’adore.
Comme l’autre n’est pas là, on commence par l’interro, pour changer. Pendant qu’ils bûchent je les compte et je les recompte, histoire de savoir combien il faudra faire de photocopies, mais j’oublie tout le temps le résultat alors je dois recommencer trois fois, entre deux séchages de front à coup de mouchoir détrempé. Ça y est, je deviens dingue.
Il arrive enfin. C’est un camarade de promo de Normale, que je ne connaissais que par fiche annuaire interposée. Ben il était mieux sur la photo. Mais je veux bien lui pardonner : il a les photocopies. Il commence son TD, je vais pouvoir souffler un peu. En bio ils leur font des TD beaucoup moins denses, on a le temps de réfléchir voire de déconner un peu avec les étudiants. Ce mec s’avère sympathique, malgré son pantalon Dockers, ses mocassins et sa petite chemise réglementaire. Ça m’amuse de comparer son look à ma barbe hirsute, ma vieille veste Adidas bleu ciel et mes baskets dégueulasses… Mais ça fonctionne bien. J’interviens de temps en temps pour faire mon matheux, on se complète assez bien, c’est tout à fait cordial.
Après il s’en va, c’est la pause avant mon tour de piste. Les étudiants sont épuisés, donc épuisants tellement ils miment à merveille la limace baveuse neurasthénique. Je fais ce que je peux. À la fin je parle avec deux d’entre eux de ce rythme d’enfer qu’on leur impose en maths. Ils acquiescent. Et de leur confier à mi-mots mon inquiétude sur l’efficacité de ce type d’enseignement. « Oh, ça va, au moins ce qui est bien avec vous, c’est que les TD sont clairs. Sans vouloir vous faire de compliments. »
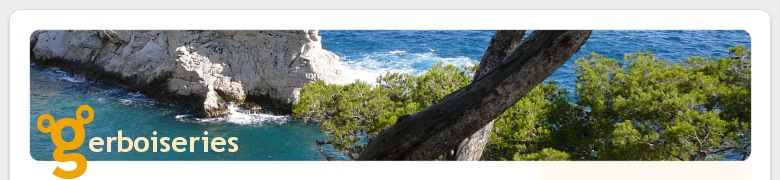
 On se donne une galerie de personnages dans une banlieue américaine, et on les regarde s’entrecroiser au gré du hasard. La plupart d’entre eux se comporte de manière incongrue, ce qui donne lieu à de multiples saynètes qui font sourire avec tendresse de ces doux dingues, constamment à côté de leurs chaussures. Les acteurs sont plaisants, ils savent être beaux, touchants dans leurs fêlures. Un film gentillet ? Certes non, il y flotte une fausse légèreté : l’absurdité apparente de ce qui s’y trame lui donne une consistance.
On se donne une galerie de personnages dans une banlieue américaine, et on les regarde s’entrecroiser au gré du hasard. La plupart d’entre eux se comporte de manière incongrue, ce qui donne lieu à de multiples saynètes qui font sourire avec tendresse de ces doux dingues, constamment à côté de leurs chaussures. Les acteurs sont plaisants, ils savent être beaux, touchants dans leurs fêlures. Un film gentillet ? Certes non, il y flotte une fausse légèreté : l’absurdité apparente de ce qui s’y trame lui donne une consistance. À un moment, il me dit qu’il est fier de moi, que j’ai fait des progrès impressionnants. Et là il se passe un truc bizarre, tellement violent qu’il me réveille à moitié, et que je ne sais plus très bien si je suis encore dans le rêve ou non. Mon corps est parcouru de spasmes violents, une sorte de crise d’épilepsie. Dans le rêve je sens que je bascule à l’horizontale, et une part de moi se détache, comme si un spectre qui m’habitait s’extrayait brutalement de ma poitrine. La forme laiteuse se laisse observer un instant puis se dissipe. Le calme revient, je reparle avec le psy, qui prend un air de « Vous voyez, je vous l’avais bien dit ». Et à mesure qu’on parle, il ressemble de plus en plus à un trav, une sorte d’Hedwig, mais aux boucles brunes, sur-maquillé, une ombre de barbe sur le visage et un rouge à lèvres écarlate.
À un moment, il me dit qu’il est fier de moi, que j’ai fait des progrès impressionnants. Et là il se passe un truc bizarre, tellement violent qu’il me réveille à moitié, et que je ne sais plus très bien si je suis encore dans le rêve ou non. Mon corps est parcouru de spasmes violents, une sorte de crise d’épilepsie. Dans le rêve je sens que je bascule à l’horizontale, et une part de moi se détache, comme si un spectre qui m’habitait s’extrayait brutalement de ma poitrine. La forme laiteuse se laisse observer un instant puis se dissipe. Le calme revient, je reparle avec le psy, qui prend un air de « Vous voyez, je vous l’avais bien dit ». Et à mesure qu’on parle, il ressemble de plus en plus à un trav, une sorte d’Hedwig, mais aux boucles brunes, sur-maquillé, une ombre de barbe sur le visage et un rouge à lèvres écarlate. Après Un Jeune Américain, deuxième volume de la trilogie auto-biographique de l’écrivain… américain. Où comment se construire une vie de pédé quand on vient du Midwest. Après un premier tome poussif, le deuxième m’a semblé plus intéressant, même si l’extase n’est pas toujours au rendez-vous.
Après Un Jeune Américain, deuxième volume de la trilogie auto-biographique de l’écrivain… américain. Où comment se construire une vie de pédé quand on vient du Midwest. Après un premier tome poussif, le deuxième m’a semblé plus intéressant, même si l’extase n’est pas toujours au rendez-vous.