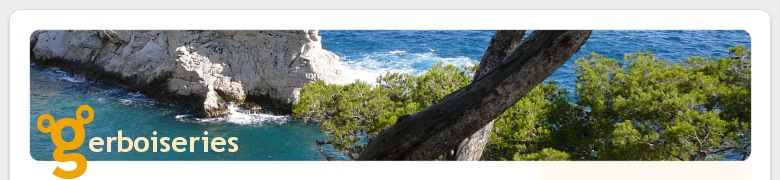Me revoilà donc proche de l’hystérie amoureuse, dans
toute son absurdité. Mauvaise nouvelle. Un SMS indélicat et tout un
monde s’effondre. Il n’a pas envie de venir prendre le thé à la maison.
L’affront suprême.
En parler avec tag est rassurant parce
qu’éclairant. Pourtant ça fait mal d’entendre « J’ai l’impression que
si ça avait dû se faire, ça se serait déjà fait ». Je prends le parti
d’envoyer un mail au Garçon, concis, pas trop drama, avant d’aller
faire un tour au Buttes.
Sur le chemin, je me dis qu’il y a tout de même des
automatismes stupéfiants. Quand il n’y a pas de point de mire affectif,
ou que les choses se barrent en couille, le recours universel c’est la
drague. Il me faut une présence virtuelle, des gens à séduire, sinon je
sombre. Une béquille émotionnelle.
J’arrive aux Buttes, les feuilles tombées
occasionnent une transparence de bien mauvais aloi. En effet, le lieu
est désert. J’en fais le tour lentement, en quête des étuis de capotes
(qui jonchent le sol, effectivement). Je me pose contre le tronc
horizontal d’un arbre presque déraciné. J’attends, pensif.
Pourquoi accorder tant d’importance à ce compagnon
potentiel ? Pourquoi suis-je toujours si pressé ? Après tout, le
bonheur se vit aussi dans le célibat, j’ai pu le voir de manière
éclatante dernièrement, cette soirée avec tag, précisément, où d’après
lui j’étais rayonnant. Le sexe dans le couple est pour moi un mystère
insondable, pas forcément très attirant. Pourquoi cette quête éperdue
de présence ?
Psychanalyse de comptoir, on va taper sur les
parents. Le manque d’amour, tellement banal, pas forcément dans les
faits, mais dans mon ressenti. Cette réussite scolaire si encombrante
pour mes parents, cette mère qui me lègue ses angoisses et ne sait pas
la tendresse, ce père qui me traite de femmelette et fait comme si les
bulletins scolaires n’existaient pas. Le besoin perpétuel de
reconnaissance, de séduire aussi. Tout en n’y croyant jamais, comme si
c’était toujours voué à l’échec. Putain, je suis loin d’être con, je
suis loin d’être moche, je suis loin d’être un psychopathe. Et je n’ai
absolument pas confiance en moi. Une entreprise de sape aussi constante
qu’insidieuse est à l’œuvre.
Un mec parcourt les sentiers. Moyen vieux, grand, à
la fois rond et carré, cheveux ras, pantalon blanc de jogging à deux
bandes, veste polaire rouge, petit bonnet noir. À deux épaisseurs de
buisson de moi, il se plante sur ses deux jambes un peu écartées. Je ne
vois pas son visage mais je sais qu’il regarde dans ma direction. Je
fais pareil. Le bas de son pantalon s’agite en ondulant. Ma main
descend dans ma poche. Putain, quelle idée d’avoir pris le gerbiPod,
quelle conne. Il s’approche, s’arrête à mi chemin, se caresse la bite à
travers le pantalon. Je l’imite. Il s’approche, m’attrape par le
paquet. je reste adossé à l’arbre, à moitié assis, il est debout à côté
de moi. Il a décousu une poche de son pantalon, on peut y passer la
main sans le déshabiller, évidemment je ne me fais pas prier. Petite
bite, circoncise, pas très pratique tout ça. Quelques grognements, ça
n’a pas l’air de lui déplaire. Lui se débat avec mon foutoir de
pantalon à poches pleines de bordel, cette braguette à boutons et cette
ceinture tout à fait indispensable pour accroître encore un peu
l’inconfort. Je finis par la retirer et la plier patiemment pendant
qu’il essaie de me caresser. Un visiteur fait mine de mater, il nous
dérange. Le mec s’arrête, me regarde, me fait un sourire, point fermé,
pouce tendu vers le haut, je suis un top, un bon coup. Pourtant on
s’est à peine branlé. Il s’en va. Voilà que j’ai perdu mon compagnon de
jeu.
Un peu plus tard, un jeune mec habillé comme un
sorbonnard coincé hésite. Il me passe deux ou trois fois sur les pieds,
me regarde furtivement, sans s’arrêter. On finit plantés comme deux
endives à deux mètres à peine l’un de l’autre. Je lance, détaché :
« Pourquoi est-ce si difficile ?
— Quoi donc ?
— D’être ici, aujourd’hui ?
— Je ne sais pas.
— Le froid peut-être.
— Et il n’y a personne.
— En effet, il faut aimer la solitude.
— Sur un lieu de rencontre !
— Oh, est-ce vraiment un lieu de rencontre ? Ce sont les solitudes qui se
rencontrent. Ou on vient pour réfléchir.
— Ah bon.
— Tu viens souvent ici ?
— Non, pourtant j’habite à côté. Trop de vieux je trouve.
— Oh, pas tant que ça, regarde nous deux !
— Il faut bien tomber aussi.
— Ou être patient.
— Je ne le suis pas trop… Bonne journée, alors. Bonne réflexion. »
Et il s’en va.
Je suis congelé, j’en ai marre de réfléchir. Il est temps de rentrer.